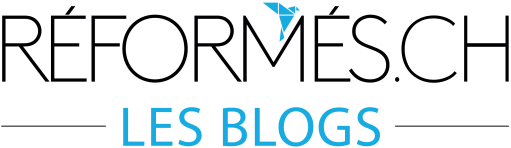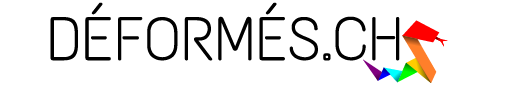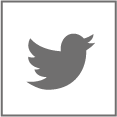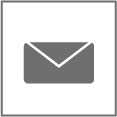Le dalaï-lama montre un chemin à plus de 16 000 personnes avides de vérité, de sagesse et de bonté
, Fribourg
«Le but des religions est de développer et de promouvoir la compassion et le pardon, pourtant les religions engendrent bien souvent des conflits et des désaccords», a lancé dimanche le dalaï-lama lors de sa conférence sur L’éthique au-delà des religions. Un manque de principes moraux et d’éthique séculière en seraient les causes. Une salle bondée écoute avec attention les paroles du chef spirituel. L’atmosphère est détendue, des enfants circulent dans les allées et sa sainteté s’exprime avec humour.
Si les différentes religions sont sources de discordes, alors qu’elles prônent toutes des valeurs de compassion et de pardon, il s’agit de montrer que ces valeurs existent au-delà des religions et réunissent tous les individus. Ces valeurs se retrouvent dans l’éthique séculière ou morale naturelle, «qui dépend de facteurs biologiques, contrairement à la foi religieuse qui dépend d’une réflexion», explique Tenzin Gyatso. La morale naturelle peut être définie comme «le fait d’être fondamentalement concerné par l’autre comme par soi-même, de par sa nature, propre aux êtres sensibles».
Trois facteurs biologiquesL’éthique séculière est liée à trois facteurs biologiques qui se retrouvent chez tout un chacun: le besoin de l’autre, le nourrisson ne survit pas sans soin. L’être humain est un «animal social», il éprouve le besoin de se rassembler et est affecté par la perte ou la souffrance d’un des siens. Le bien-être physique et psychique sont intimement connectés; la recherche scientifique a montré que «la colère et la haine dévorent le système immunitaire».
Elle est ainsi l’unique moyen de réunir tous les individus selon des valeurs de «respect, de compassion et d’amour». «Le moment est venu de développer internationalement un système éducatif basé sur l’éthique séculière, en d’autres termes sur les valeurs humaines fondamentales, qui pourrait être accepté par tous et qui ne dépend pas des religions», déclare le moine.
Un public conquisC’est un public conquis qui quitte l’auditoire. «Je suis toujours comblée par les enseignements de sa sainteté», s’illumine une femme en longue robe, venue de Londres, et qui assiste régulièrement aux conférences du dalaï-lama. Plus loin, un jeune homme suédois est arrivé à Fribourg expressément pour trouver «la vérité et la bonté» auprès du maître spirituel tibétain, après avoir étudié le bouddhisme dans un monastère en France.
«Cette philosophie m’apporte la paix, pourtant je ne pense pas que les Européens puissent être bouddhistes», explique une jeune femme qui a vécu au Tibet. Elle pense que dans notre civilisation occidentale, il est impossible de vivre fondamentalement le bouddhisme. «Moi-même, j’utilise les enseignements du dalaï-lama mais je ne me considère pas comme bouddhiste».
Cette rencontre du Forum de Fribourg a été organisée par l'Association bouddhiste Rigdzin Suisse - créée en 2002 pour permettre l’étude et la pratique du bouddhisme tibétain, par l’Association Gendrun Drup - fondée en 2004 à Sierre ainsi que par La Fondation pour la préservation de la culture du Tibet et pour la promotion de l’échange interculturel (FPC-Tibet). Le dalaï-lama poursuit dès lundi ses conférences aux Universités de Lausanne, de Berne ainsi qu’à l’Institut tibétain de Rikon (ZH).
« Nous souhaitons tous une vie heureuse, mais avant il faut se considérer comme des êtres humains», explique Tenzin Gyatso. Selon le dalaï-lama, il est nécessaire de se considérer comme un «être humain» et non pas comme un bouddhiste, un chrétien ou un Suisse pour pouvoir accéder au bonheur. «En mettant l’accent sur ces «caractéristiques secondaires», nous créons une distance avec les personnes qui ne les partagent pas et c’est la base de tous les conflits car l’individu se sent davantage «suisse» qu’être humain», souligne le Tibétain. LV