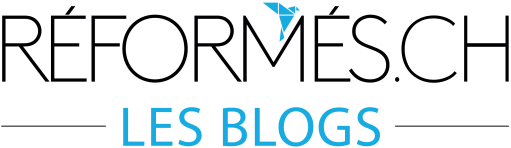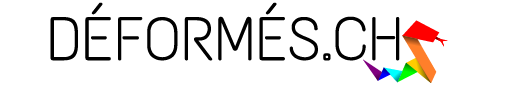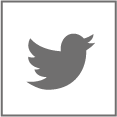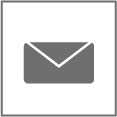De la non-binarité à la dialectique
L'épisode Nemo et sa revendication de non-binarité donne à penser bien davantage que je ne l'estimais en écrivant un premier blog à ce sujet. La pensée binaire encombre, en effet, la réflexion, en particulier théologique. On réfléchit, en effet, souvent en affirmations exclusives les unes des autres. On dira ainsi qu'il est établit que Dieu existe. D'autres rétorqueront qu'il est établit que Dieu n'existe pas. Aucun dialogue n'est possible entre ces deux positions absolutisées et totalisantes. On ne peut que s'invectiver et peut-être en venir aux mains. Il en va encore ainsi entre ceux qui affirment que le christianisme est la seule vraie religion et ceux qui défendent qu'il y a du vrai dans toutes les religions. Ou entre ceux qui prétendent que tout est prédéterminé et ceux qui entendent que notre liberté est totale. Ou entre ceux qui affirment que la Palestine revient de droit aux Israéliens et ceux qui affirment qu'elle revient de droit aux Palestiniens...
Sceptiques et dogmatiques
A chaque fois la thèse défendue se veut englober la totalité du problème (l'existence de Dieu, la vérité de la religion, la liberté, l'histoire de la Palestine). Et on applique le principe logique du tiers-exclu. C'est soit... soit... Soit il est établi que Dieu existe, soit il est établi qu'il n'existe pas. Dans l'Antiquité l'école sceptique baptisait de « dogmatistes » ceux qui défendaient de telles thèses. Elle se faisait un malin plaisir de renvoyer dos à dos ces dogmatistes. Elle demandait qu'en de telles circonstances on suspende son jugement et qu'on poursuive la recherche. Mais attention ! trop souvent on a réduit le scepticisme à la suspension de son jugement. On renverrait simplement les parties dos à dos. On oublie que les sceptiques incitaient à poursuivre la recherche de la vérité. Au nom de la suspension de leur jugement, certains se sont pourtant mis à défendre la thèse agnostique, sans ne plus poursuivre la recherche. Cette thèse pose qu'on ne sait pas si Dieu existe ou n'existe pas. Le principal intérêt manifesté par ceux qui défendent ce point de vue réside dans le désir d'éviter que les croyants et les athées se déchirent, en viennent à s'excommunier, voire à s'exterminer. Ils décident par gain de paix que le problème de l'existence de Dieu est un faux problème, un problème que l'on peut parfaitement mettre entre parenthèses. On pourrait vivre parfaitement bien sans se préoccuper de Dieu.
Vous êtes embarqués
Ici intervient l'ami Blaise Pascal. Il dit aux agnostiques : « Vous ne pouvez suspendre votre jugement. En effet, vous êtes « embarqués ». Ne pas se prononcer à propos de l'existence de Dieu revient à la nier. « Si vous ne pouvez effectivement pas décider en raison entre l'existence ou la non-existence de Dieu, alors pariez ! ». On redevient binaire, car on ne peut que parier que Dieu existe ou parier qu'il n'existe pas. Et Pascal de montrer que l'enjeu du pari est tellement grand, qu'il vaut infiniment la peine de parier pour l'existence de Dieu plutôt que contre elle. Mais ici on remarquera que Pascal ne dit plus qu'il est établi que Dieu existe ou qu'il n'existe pas. Pour lui, en effet, Dieu est tout autre que tout ce que nous connaissons de sorte que l'on ne peut rien « établir » rationnellement à son propos. Pascal a donc entendu la leçon des sceptiques. Il a poursuivi la recherche. Il a découvert que l'existence comme la non-existence de Dieu était une question de pari, de foi, d'engagement personnel. On s'engage sans preuve en faveur de Dieu comme on peut s'engager sans preuve contre son existence. Mais, dès lors qu'on accepte ainsi que la question de l'existence ou de la non-existence de Dieu dépende de notre choix personnel, on n'a plus non plus de raisons de s'entre-déchirer les uns les autres à ce propos. On ne peut qu'accepter (« tolérer ») le choix de l'autre, même si on est persuadé qu'il est erroné.
Contraires et sub-contraires
Si on reproduit ce qui vient d'être développé sur le plan de la logique, on peut dire que la position de départ où les uns affirmaient qu'il est établi que Dieu existe et les autres qu'il est établi que Dieu n'existe pas opposait deux thèses dites « contraires ». Elles ne peuvent pas être simultanément vraies, mais elles peuvent être toutes deux fausses (ce que défendent les sceptiques). Les deux thèses « sub-contraires » qui peuvent toutes deux être vraies, mais ne peuvent être simultanément fausses affirment l'une qu'il est possible ou plausible que Dieu existe et l'autre qu'il n'est pas établi que Dieu existe. En conjuguant ces deux thèses, cela donne qu'il n'est pas impossible, même si cela n'est pas établi que Dieu existe. Il est possible de contester l'existence de Dieu et pourtant rien n'empêche rationnellement de croire qu'il existe... Pascal en déduisait qu'il n'était absolument pas irrationnel de croire. Ainsi la raison et la foi ne s'opposent pas. La raison n'est pas l'apanage des athées. Les athées aussi sont des croyants qui croient à leur manière.
Devant Dieu, devant le monde
En matière de pensée binaire, on est parti d'une opposition forte entre défenseurs du fait que l'existence ou la non-existence de Dieu est un fait établi. Il n'y a pas de position tierce possible. Les sceptiques ont montré que cette pensée binaire ne tenait pas la route. Il s'agissait de poursuivre la recherche tout en rejetant l'opposition binaire. En poursuivant la recherche, Pascal est revenu à une position binaire. Cependant ce n'était plus au plan de la raison qui établit que..., mais au niveau de l'engagement personnel où l'on croit en... On est embarqué, on ne peut donc en matière de foi, suspendre son jugement. Cela n'est pas possible face à l'absolu. La pensée binaire, lorsqu'elle travaille correctement n'a rien donc de répréhensible. Elle l'est seulement quand elle absolutise ce qui ne peut ou ne doit pas l'être. Lorsqu'il est question de Dieu, on ne peut être que binaire. Lorsqu'il s'agit de notre raison limitée, on ne doit pas nécessairement l'être.
En situation dialectique
Est-ce à dire qu'il est interdit ou simplement dangereux de faire preuve de binarité lorsqu'on pense des réalités qui ne sont pas absolues ? J'évoquais plus haut la tension binaire entre les tenants d'un déterminisme absolu et ceux qui affirment notre radicale et naturelle liberté. Voilà un exemple de binarité qui n'est pas rapportée à un réel absolu. Il s'agit de la grave question de ma liberté à moi, être relatif. Les premiers vous démontreront que même votre idée selon laquelle vous avez la possibilité de faire ce que bon vous semble relève de votre conditionnement. Jamais vous ne faites ce que bon vous semble, ce que vous désirez, ce à quoi vous êtes attachés. Les aficionados de la radicale liberté vous diront de ne pas écouter ces prophètes de malheur : vous avez toujours au moins la possibilité de vous situer par rapport à ce qui vous détermine, vous conditionne, fait de vous des esclaves. Même dans la situation la plus extrême, vous avez toujours la possibilité de vous ôter la vie pour ne pas à avoir être un pur esclave. Ces deux positions ne semblent cependant pas aussi « binaires » qu'elles paraissent. La liberté absolue est contredite par nos expériences quotidiennes qui nous montrent que nous ne pouvons pas seulement faire tout ce que nous voulons, mais que bien souvent nous ne pouvons même pas nous situer librement à l'égard de ce qui nous arrive. Il y a si souvent des situations où nous ne pouvons faire autrement. Si mon fils tombe à l'eau sans savoir nager, je puis naturellement décider de le laisser mourir, mais en principe je fais tout pour le sortir de sa dangereuse situation. Je ne puis autrement. Quant au déterminisme absolu, il est auto-contradictoire. Admettons que, par pure hypothèse, tu aies raison et qu'effectivement tout soit déterminé. Il en résulte que tu es déterminé à penser que tout est déterminé alors que je suis déterminé à penser que je suis complètement libre. Les deux positions totalisantes ne tiennent donc pas la route. La vérité doit se trouver entre deux. Mais cet entre-deux n'est pas un point fixe. Il y a des moments où le conditionnement est extrême et la liberté réduite à très peu de choses. Il en est d'autres où la possibilité de vivre selon ses principes s'avère bien plus importante que ce qui nous détermine. Cette situation d'un entre-deux qui ne se tient jamais aux deux extrêmes est ce que l'on dénomme habituellement une situation dialectique. Elle se vit dans la tension entre deux pôles dont on sait que l'un ne peut jamais être sans l'autre. Elle représente en un sens une situation non-binaire, car elle nie toute possibilité de se fixer sur l'un des pôles entre lesquels elle se vit. Pourtant elle ne se vit pas ailleurs que dans cet entre-deux.
Il se pourrait bien qu'en matière de sexualité et de genre on se trouve aussi dans une situation dialectique... Il se pourrait aussi que la solution au problème de la Palestine relève de la dialectique, donc du dialogue...