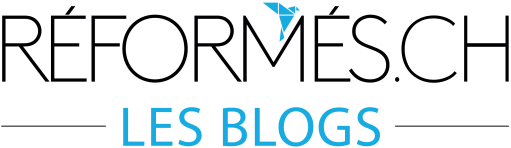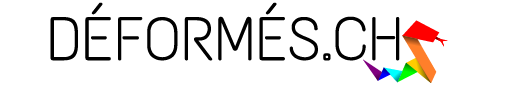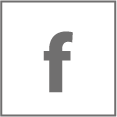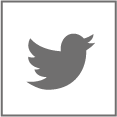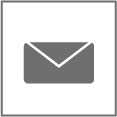Votations du 12 février: Retrouver le sentiment du «nous»
Noriane Rapin, stagiaire à Médias-pro, réfléchit à ce que signifie «être suisse».
Photo: Joeri Cornille CC(by)
Le 12 février prochain, le peuple suisse sera appelé à se prononcer sur la naturalisation facilitée de la troisième génération. Si elle est acceptée, la nouvelle procédure permettra à un certain nombre de jeunes (estimés à 25’000) de devenir suisses, dont les grands-parents ont rejoint la Suisse dans les années 60 et dont au moins un parent est né dans ce pays. Pas d’enjeux économiques, donc, et un impact relativement peu important. Mais il reste que cette votation symbolique alimente un débat parfois pesant.
En lisant les journaux et en parcourant les réseaux sociaux ces dernières semaines, j’ai été profondément interpellée par deux choses (en dehors des affiches consternantes des opposants, mais faut-il vraiment s’en étonner?). D’une part, le fait que leurs descendants doivent se naturaliser signifie que certains «secundos» n’ont pas souhaité entamer la procédure eux-mêmes, malgré qu’ils soient nés en Suisse. D’autre part, plusieurs acteurs de la vie politique et culturelle ont affirmé ne pas savoir ce que signifiait être suisse, que ce pays et ses habitants n’avaient pas de caractéristiques propres, et que finalement «on s’en fiche!». Ces deux états de fait m’ont mise mal à l’aise: à quoi bon proposer une procédure de naturalisation facilitée, puisque finalement, être suisse, cela ne change rien? Et pourquoi ai-je l’impression d’un échec cuisant quand je pense une telle chose?
Le 22 janvier dernier, le Temps a publié une interview du sociologue Sandro Cattacin, qui met en lumière les doutes et les réticences de la deuxième génération d’immigrés dans les années 1980-1990. Si beaucoup d’entre eux n’ont pas voulu de la naturalisation, c’est parce qu’ils voulaient éviter une démarche perçue comme humiliante, eux qui n’avaient jamais vécu ailleurs qu’en Suisse. Après avoir exposé les tristes conséquences de la xénophobie helvétique, le sociologue conclut l’article par ces mots: «Le “nous” à Genève, dans une ville pluriculturelle (...) c’est une tout autre histoire que le “nous” à Frauenfeld ou à Herisau. Le “nous” suisse n’existe pas!» On ne peut que s’incliner devant l’évidence que la haine de l’étranger a fait d’énormes dégâts chez les immigrés et leurs enfants, et qu’elle a gravement mis en danger notre vie communautaire à plusieurs reprises. Mais la crainte légitime du nationalisme justifie-t-elle la conclusion de M. Cattacin? Doit-on vraiment dire que, puisque les Suisses sont si différents entre eux, leur sentiment d’appartenance à un même pays n’est qu’une construction idéologique et néfaste?
Pourtant, même si je me refuse à sacraliser l’idée de nation ou à m’enorgueillir d’un passé fantasmé, la Suisse est une réalité objective! Historiquement, elle s’est constituée canton par canton, souvent parce que ces derniers ont choisi de rejoindre les Confédérés pour des raisons économiques ou militaires. Aujourd’hui, nous héritons d’un pays hétéroclite, d’une construction un peu artificielle qui paraît chanceler à chaque votation. Mais je ne peux m’empêcher d’être fière (je brise le tabou) d’un pays qui continue de fonctionner malgré les barrières de la langue, de la culture et des idées. Si tout ce que nous pouvons offrir en tant que Suisses à ceux qui souhaitent nous rejoindre est l’envie de construire ensemble malgré les différences, je trouve que c’est déjà un bon début.
L’essayiste Régis Debray, ancien conseiller de François Mitterrand, a dit: «On a besoin de retrouver le sentiment du “nous” au-delà de nos “moi-je”.» Aujourd’hui, il est très à la mode de discréditer le «patriotisme», sans doute parce qu’on l’assimile trop souvent au nationalisme. Mais n’oublions pas qu’un Etat est une entité indispensable: il aide l’individu à se constituer, quel que soit son âge ou son statut social. C’est un projet pour lequel il vaut la peine de s’investir, et si les citoyens ne se réjouissent pas de ses réussites, qui le fera? Pas étonnant que certains «secundos» n’aient pas voulu passer par les épreuves de la naturalisation: un pays qui a honte de lui-même conserve-t-il un attrait quelconque? Assimiler un pays à une nation hermétique, à une race ou à une religion est une idéologie mortifère. Refuser à ce même pays le droit d’exister et d’en être fier ne constitue pas une réponse adéquate, et ne servira pas la cause de la troisième génération. Pour moi, il importe que ceux qui contribuent à ma patrie (encore un mot interdit) et vivent depuis longtemps dans ses frontières soient reconnus comme Suisses. Si la Confédération considère qu’ils le sont autant que moi, cela change tout: être Suisse, ce n’est pas être de la bonne couleur, du bon parti, de la bonne famille; ce n’est pas non plus un simple bout de papier qui ne veut rien dire. C’est être enfant et participant d’un pays pluriel qui tient depuis toujours grâce à la bonne volonté et au travail commun de ses habitants.