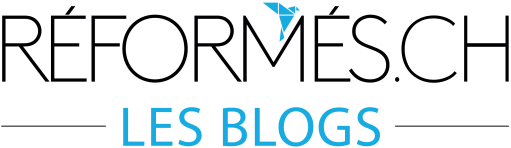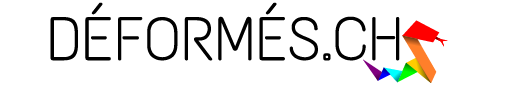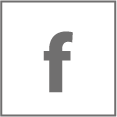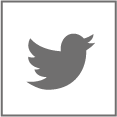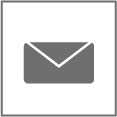Moi, pasteure et en dépression
«Je pensais avoir atteint le fond, mais en fait je n’ai encore rien vu. Durant les semaines qui suivent, je m’enfonce de plus en plus profondément dans le marécage de la dépression. Je m’embourbe dans mes pensées, je patauge dans la tristesse.» Avec une écriture acérée et sans faux-fuyant, la pasteure Bettina Beer affronte de face la dépression dans laquelle elle s’est débattue de longs mois. Publié dans une petite maison d’édition française, «Un océan de tristesse» est le témoignage vibrant de ce combat, au jour le jour. Entretien avec celle qui est aujourd’hui chargée des relations avec les Églises au sein de l’Église évangélique réformée de Suisse (EERS) et par ailleurs nouvelle co-présidente des Verts fribourgeois, autour de ce thème aussi important que douloureux et de ses ramifications avec la foi et les milieux d’Église.
dépressionDans ce livre, vous racontez la dépression que vous avez traversée. Qu’est-ce qui vous a motivée à la rendre publique?
Je n’ai premièrement pas écrit ce livre dans ce but. L’idée de la parution m’est venue dans un deuxième temps, une fois que son écriture était achevée. «Si je l’ai écrit, autant qu’il soit lu!» me suis-je alors dit. Et puis si mon histoire peut servir à lever ce tabou autour de la dépression, tant mieux. On parle bien sûr plus facilement aujourd’hui que par le passé de la dépression, mais cela reste toujours plus difficile à assumer que d’annoncer que l’on a un cancer. On s’attend toujours à des réactions comme «T’as qu’à te secouer!», «Bouge-toi un peu!». Les troubles mentaux, ce n’est pas comme une tumeur que l’on peut montrer sur une IRM: c’est plus insaisissable et ça fait aussi peur à beaucoup de gens.
Avez-vous l’impression que la dépression est encore un tabou dans les milieux d’Église?
Je répondrais que cela dépend de qui a la dépression! Parmi les professionnels de l’Église, on a pas mal sensibilisé pour accompagner les paroissiens et les jeunes qui sont dépressifs ou ont un autre problème de santé mentale. Évidemment, les pasteurs et les diacres ne sont pas des psychothérapeutes ou des psychiatres – ils n’en ont d’ailleurs pas la prétention –, mais ils peuvent offrir des entretiens de relation d’aide et, dans ce cadre, ils peuvent parfois se rendre compte que le malaise nécessite un vrai suivi et inviter la personne à entreprendre cette démarche. Mais quand c’est le pasteur ou la diacre qui va mal, cependant, j’imagine bien que cela est plus difficile à avouer...
Vous-même, en tant que pasteure de profession, même si vous n’êtes plus en fonction dans ce rôle, cela vous culpabilisait-il encore davantage?
Je ne parlerais pas de culpabilité. Pour ma part, ce qui a été difficile, ça a été de me rendre compte que j’étais malade. Cela m’a pris six mois pour vraiment l’admettre, jusqu’à ce que je sois hospitalisée. L’hospitalisation a été le point le plus bas dans ce parcours, mais aussi le tournant vers le mieux. En tant que croyant ou croyante, et encore plus en tant que pasteur, forcément, on s’interroge: «Ne devrais-je pas avec ma foi avoir les moyens de ne pas en arriver là? Ne devrais-je pas avoir les ressources pour ne pas plonger aussi bas?»
Vivre une dépression quand on est croyant, qu’est-ce que cela change?
Pour ma part, je ne me suis jamais dit que si j’étais malade, c’était parce que ma foi ne me portait pas assez. Ce n’est pas le manque de foi qui m’a fait tomber malade. Par contre, je me suis posée pas mal de questions sur pourquoi ma foi ne m’aidait pas plus. Or à un moment, j’ai accepté que c’était une maladie, que celle-ci n’était pas liée à mes convictions ni à mes valeurs et que, comme toute maladie, elle se soigne par le biais de médicaments et une thérapie. Et puis, évidemment, avoir la conviction de la présence d’un Dieu qui nous porte et qui est toujours à nos côtés, cela aide aussi. Cela m’a beaucoup aidée à un moment donné. Mais je ne dirais pas non plus que c’est ça qui m’a sauvée. Clairement, c’est la thérapie et les médicaments qui m’ont sauvée. La foi, c’était une béquille supplémentaire comme d’autres: les relations, le repos, le sport, etc.
Vous parlez sans détour des idées suicidaires qui vous ont traversée. Comment cette tentation se conjugue-t-elle avec la foi?
Quand la tentation de mourir est là, c’est tellement envahissant qu’il n’y a plus de place pour rien d’autre à côté. Peut-être peut-on comparer cette tentation à quelqu’un qui est dépendant à une drogue. Quand il est en manque, il a beau essayer de réfléchir de manière rationnelle, ça n’arrive même pas jusqu’à son cerveau: parce que le manque est là et va le pousser à consommer. Ces derniers temps, je me suis par ailleurs rendue compte que, paradoxalement, croire en un au-delà auprès de Dieu représente finalement un certain danger quand on est dépressif.
Comment cela?
Face aux envies suicidaires, avoir peur de la mort ou des doutes sur ce qu’il adviendra ensuite est souvent un frein. La peur joue un rôle de garde-fou. Or, pendant cette période, je me suis rendu compte que je n’avais pas du tout peur de mourir, et cela précisément par que je suis convaincue que la mort ne va pas me couper de Dieu – au contraire, je serai encore plus près de lui. Où que je sois, quelle que soit la manière dont cela sera, ça m’est complètement égal: je serai avec Dieu. Du coup, quand on a cette certitude, la barrière face au suicide est moins grande, le passage à l’acte moins inquiétant...
Dans la théologie catholique, le suicide a pourtant souvent été considéré comme un péché. Or là, vous dites que le suicide gagnerait en attrait quand on est croyant...
On retrouve aussi ce discours chez des réformés, qui disent que vouloir mourir, c’est contraire à la volonté de création et d’humanité de Dieu. Mais pour moi, les idées suicidaires sont clairement liées à la maladie: on n’en est pas coupable, ce n’est pas de notre faute. Quand on a l’impression de se dissoudre complètement, que tout s’effondre, il n’est absolument pas question de péché. Et ça, Dieu le sait, il voit que c’est la maladie qui nous submerge qui parle.
Comment allez-vous aujourd’hui?
Je sais que je ne suis pas encore tirée d’affaire, mais je vais mieux. Je sais cependant aussi qu’il faut compter avec le risque de rechute. D’après ce que je sais du fonctionnement de la dépression, il y a des épisodes dépressifs. Une fois qu’on est guéri d’un épisode et qu’il n’y a pas eu de symptôme pendant six mois, on est considéré comme guéri. Au-delà, on n’a pas affaire à une rechute, mais à un nouvel épisode dépressif, sachant que chaque nouvel épisode augmente le risque d’en connaître d’autres. D’où l’importance de mettre des mesures concrètes en place en guise de prévention (gestion du sommeil, rythmes réguliers, etc.)
Qu’est-ce que cette épreuve vous a appris?
J’ai appris à mieux me connaître. La thérapie a été hyper douloureuse, mais en même temps bénéfique. J’ai appris qui j’étais vraiment. Je croyais faire certaines choses par envie, mais des raisons plus obscures m’animaient. Aujourd’hui, j’ai appris à m’affirmer davantage, ce qui est parfois un peu déstabilisant pour mes proches... J’ai appris à mieux prendre soin de moi et à écouter mes besoins, c’est comme un deuxième élan.
Et sur le plan de la foi?
Je dirais que je comprends mieux pourquoi certains textes bibliques me touchent plus que d’autres... J’ai surtout compris que la dépression n’était pas quelque chose à prendre à la légère et que les Églises ont vraiment un rôle à jouer dans ce domaine. Que ce soient les pasteurs, les diacres, les bénévoles, les catéchètes et les Jack (jeunes accompagnants de camps et de catéchèse), toutes ces personnes entrent en contact avec beaucoup de monde. Elles ont donc un rôle de sentinelle à jouer, ce d’autant plus quand on sait la prévalence de personnes qui sont en souffrance psychique au moins une fois au cours de leur vie*. Il est important de repérer les signaux d’alerte et d’inciter ces personnes à consulter avant qu’il ne soit trop tard. Avant que l’une d’entre elles ne se jette d’un pont.
Concrètement, comment les Églises peuvent-elles agir?
Différentes actions peuvent être entreprises. Pendant la période du carême, l’EERS a par exemple mené une campagne de sensibilisation nommée «À ton écoute». L’idée c’était de rappeler que dans le cadre de l’Église, il y a des gens dont la spécialité, c’est précisément d’écouter. L’EERS, sur demande de certaines Églises cantonales, va voir comment elle peut les soutenir et promouvoir l’offre de cours de premier secours en santé mental (Ensa), basé sur le modèle des cours de premier secours obligatoires pour passer le permis de conduire. L’idée est que toute personne ait les bases pour réagir face à une personne qui va mal. Parce que la pire des choses, c’est de ne rien faire. Or la plupart du temps, on n’ose pas aborder la personne, parce que l’on ne sait pas quoi dire. Les Églises Berne-Jura-Soleure (BEJUSO) ont déjà commencé à proposer ces cours, en 2019, aux différents acteurs sur le terrain: pasteurs, diacres, animatrices de jeunesse. L’EERS est en train de réfléchir comment coordonner à présent cela au niveau suisse. Comme vous pouvez l’imaginer, ce projet me tient très à cœur.
A lire
«Un océan de tristesse»
De Bettina Beer
Ed. Trois Colonnes, 152 p.