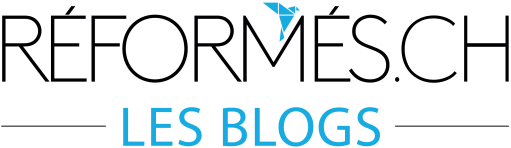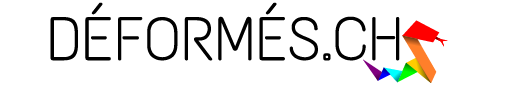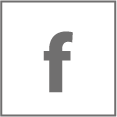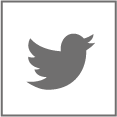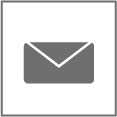Et si l’affaire Mila avait surgi en Suisse?
En France, la controverse fait rage suite à la désormais «affaire Mila», du nom de cette adolescente menacée de mort après avoir insulté les religions, et plus particulièrement l'islam, sur son compte Instagram. Suite au déferlement de haine et d’intimidations, pour certaines très concrètes, la jeune fille a dû être déscolarisée.
S'exprimant sur l'affaire Nicole Belloubet, ministre de la justice, a déclenché une vive polémique. Si elle a condamné ces menaces de mort, la garde des Sceaux n’en a pas moins déclaré, dans un premier temps, que «l'insulte à la religion» était «évidemment une atteinte à la liberté de conscience». Vivement critiquée, celle-ci est donc revenue sur ses propos, qu'elle a qualifiés dans un premier temps de «maladresse», puis «d'erreur», pour convenir que le délit de blasphème ne saurait exister en France. Mais qu’en est-il en Suisse? Éclairage avec David Zandirad, juriste, doctorant et spécialiste de la liberté religieuse
En tant que juriste spécialiste de la liberté religieuse, quel commentaire vous inspire ce cafouillage?
Ce cas est symptomatique de la confusion régnante autour du vocable « blasphème », qui n’a jamais véritablement disparu de nos lexiques pénaux, et des liaisons intimes qu’il entretient avec la politique, le politique devrait-on dire.
En étant volontairement caricatural, cette affaire cristallise presque à elle seule la polarisation du débat public sur la question de la laïcité en France, entre d’une part les tenants d’une supériorité sans contredit de la liberté d’expression sur la protection du sentiment religieux, et d’autre part ceux qui exigent un ménagement dans l’exercice de la liberté d’expression qui devient abusive lorsqu’elle manifeste un « irrespect » de la religion.
Elle illustre à merveille les limites de la maxime de la liberté des Modernes qui consiste à pouvoir faire « tout ce qui ne nuit pas à autrui » (art. 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen). Avec l’hétérogénéisation des valeurs au sein de nos sociétés occidentales, il devient de plus en plus difficile pour les tribunaux de prendre des décisions qui assurent une harmonie sociale générale.
Qu'en est-il du côté de la législation suisse en la matière?
L’art. 261 du Code pénal suisse (CP) qui s’intitule « Atteinte à la liberté de croyance et des cultes » punit d’une peine pécuniaire « celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou bafoué les convictions d’autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu […] ».
Le droit pénal suisse ne connaît pas de délit de blasphème à proprement parler mais punit les propos et les actes qui visent le mépris et le dénigrement des croyances d’autrui. Ce n’est donc pas la divinité ou la religion en tant que telles qui sont protégées mais le sentiment religieux. De plus, il faut préciser que la jurisprudence interprète sévèrement le degré de profanation requis pour tomber sous le coup de la loi en exigeant que l’atteinte soit particulièrement répréhensible selon les règles sociales généralement en vigueur au regard du contenu religieux.
En Suisse, comment seraient traités ces propos?
La Suisse connaît une tradition juridique différente et un rapport historique aux religions qui est propre à chaque canton. À mon sens, la procédure pénale ouverte contre Mila n’aurait pas été classée aussi vite qu’elle le fut par le parquet en France, car l’art. 261 CP vise des propos plus larges que la «provocation à la haine raciale». Il est risqué et difficile d’établir un pronostic de condamnation ou d’acquittement pour un tel cas en Suisse, mais il s’agit d’un cas que l’on peut qualifier de limite.
Selon la législation suisse, à quel moment est-il considéré que l'on a enfreint un délit de blasphème?
En vertu de notre cadre contemporain et occidental, cette affaire nous renvoie immédiatement et assez trivialement aux droits de l’homme. D’un côté, nous avons la liberté d’expression, qui comprend la liberté de critiquer des dogmes religieux, par le biais de propos politiques, de productions littéraires ou artistiques ou encore de caricatures satiriques voire purement railleuses. Cette liberté vaut non seulement pour les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, nous dit la Cour européenne des droits de l’homme, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population. À l’opposé, la liberté religieuse protège le sentiment religieux des croyants, qui comprend le droit au respect de ses croyances religieuses.
Où se situe la limite précisément?
La liberté religieuse agit de la sorte comme limite à la liberté d’expression, en venant borner cette dernière mais de façon extrêmement abstraite, avec le paradoxe suivant : les droits de l’homme, vus comme universels et immuables, ne peuvent pas apporter de réponse satisfaisante à la question du blasphème puisque sont en jeu deux droits de l’homme essentiels à toute société démocratique et laïque.
Dessiner ainsi une frontière précise et rigide entre la liberté d’expression et le délit de blasphème est chose impossible. C’est une frontière à la ligne sinueuse et évolutive, qui s’adapte au gré des incessants changements de mœurs et du contexte socio-historique en vigueur. Le blasphème est en quelque sorte indexé au degré de sécularisation d’une société.
Comment comprendre que la Suisse ait choisi de maintenir ce délit? A vos yeux, son maintien dans la législation se justifie-t-il?
Il ne faut pas perdre de vue que ce n’est que dans les sociétés occidentales sécularisées, et seulement aux yeux des non-croyants, que la notion de blasphème est privée de légitimité en en perdant jusqu’à son sens. Contrairement à ce que prétend la doxa ambiante, le blasphème, quelle que soit l’appellation légale qui le réprime, a encore une certaine vigueur dans notre démocratie sécularisée parce que précisément une partie de la société estime toujours digne de protection juridique ce fameux «sentiment religieux».
Récemment, une motion a été déposée au Conseil national pour abroger l’art. 261 CP, considérant que cette infraction est «anachronique» dans un État laïque et libéral, et de donner l’exemple d’autres pays européens qui l’ont aboli récemment (le Danemark, la Norvège et l’Irlande récemment). Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la mention, mettant en avant sa fonction de protection du «vivre ensemble». Quand bien même cet article était abrogé à l’avenir, l’on ne serait pas nécessairement à l’abri de procès et de condamnations de propos jugés anti-religieux. Plus que les textes légaux, c’est la pratique juridique qu’il faut examiner. L’exemple français est frappant à cet égard.
Quels problèmes soulève son application, notamment à l'ère des réseaux sociaux?
Le blasphème est un délit qui s’est modelé itérativement, par à-coups successifs, souvent aux dépens de l’auteur de l’acte incriminé qui apprend en avoir commis un qu’après sa condamnation. Plus que le problème du traçage de sa ligne de démarcation avec la liberté d’expression, elle pose un problème de prévisibilité en ce qu’il est très difficile de déterminer à partir de quand bascule-t-on du droit au délit de blasphème, car le juge doit attendre la réception d’un acte ou d’un propos par le corps social, pour ensuite évaluer la portée et l’ampleur de l’atteinte portée à la paix sociale.
Le cas en cause ici met en lumière la puissance des réseaux sociaux qui, à l’heure de la globalisation des moyens de communication, agissent comme de formidables vecteurs de communication. La moindre photo ou phrase publiée sur un réseau social est susceptible de se propager instantanément par-delà toutes les frontières physiques, et de se cristalliser à tout jamais sur la toile. Par conséquent, les individus doivent réfléchir à deux fois avant de s’exprimer sur les réseaux sociaux, car ils doivent s’attendre à ce que leurs propos échappent définitivement à leur maîtrise une fois déclamés…