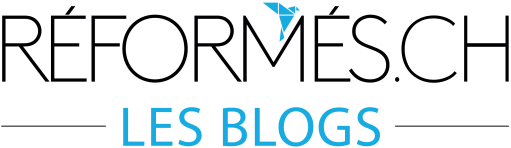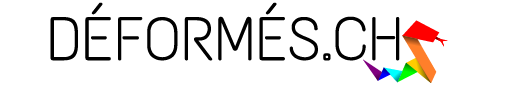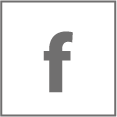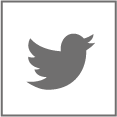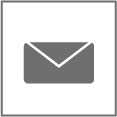Comment réguler sa voracité?
Au cours de notre conception, notre corps est englobé dans celui de notre mère. L’un des premiers apprentissages d’un enfant, c’est de se séparer de l’autre, cela ne survient pas immédiatement après la naissance. «Ce processus peut prendre huit ou neuf mois. Et ce n’est que dans sa deuxième année de vie qu’un bébé se reconnaît dans un miroir, et que sa notion du ‹moi› est ancrée», rappelle la psychothérapeute genevoise Dragana Favre. L’une des premières limites que nous intégrons est donc physique. Si elle demande une séparation de la «fusion» maternelle, cette distance procure aussi «un sentiment de sécurité, permet à l’enfant de comprendre qu’il est lui-même, et qu’il n’est pas fondu dans un grand tout».
Saine transgression
Nos «limites» sont de plusieurs ordres: normes sociales, culturelles, lois physiques, biologiques… Les inculquer, en tant que parent, c’est donc placer l’enfant face à la frustration. «Ce qui est de plus en plus difficile pour de jeunes parents. Pour éviter des crises ou par réflexe, ils offrent facilement des petits jouets, des babioles. Résultat, les enfants ont de moins en moins le temps de rêver, de désirer», observe une ancienne thérapeute au centre de psychiatrie pour l’enfance et l’adolescence de Neuchâtel. Ne plus avoir de besoins ou d’envie, c’est ne plus se confronter à des limites.
Or cette confrontation est essentielle tout au long de notre existence. Le mécanisme de transgression des limites, qui permet d’affirmer son identité, de choisir ses appartenances, est ainsi profondément sain, rappelle Dragana Favre. Qui précise cependant qu’un ado qui joue avec les limites «ne vise pas à les faire disparaître… mais à s’assurer de leur existence. Quand on teste, c’est pour voir jusqu’où aller, pour chercher une réaction. Parce que cela rassure»!
Adultes, nous continuons à flirter et dialoguer avec nos limites «en nous-mêmes, pour comprendre comment notre identité change et évolue, si nous sommes fidèles ou non, au fil du temps, à l’ado que nous étions. Nous consolidons et reconsolidons en permanence nos apprentissages», explique Dragana Favre.
Un cerveau conçu pour la croissance
Souci: sur le plan écologique, nous vivons un bouleversement sociétal qui nous oblige à revoir divers apprentissages. Les limites planétaires, le manque de certaines ressources, nos modes de vie devenus non soutenables nous imposent des comportements de consommation plus sobres. Or, pour le moment, nous sommes peu enclins à les embrasser massivement.
Alors, comment intégrer ces nouvelles limites, alors que la sobriété, même si elle se veut «heureuse», peine à être perçue comme «sexy», et surtout comme évidente?
Au niveau individuel, la première démarche consiste peut-être à comprendre d’où viennent nos comportements de consommation compulsifs. Dans son livre Le Bug Humain, le docteur en neuroscience Sébastien Bohler insiste sur leur origine neurobiologique. Selon lui, c’est le décalage entre notre cerveau – conçu il y a des milliers d’années pour «consommer le plus possible, copuler le plus possible» et d’accumuler autant que possible – et notre réalité qui pose problème. Car la société et l’«appareil industriel» sont pour la première fois capables de satisfaire nos désirs de manière illimitée. Nous serions, selon Bohler, victimes de notre cerveau, qui nous incite à chercher «toujours plus d’argent, de nourriture, de sexe, de statut social».
La psychologie de la santé offre un discours plus nuancé. «En réalité, nos comportements sont le fruit d’équilibres psychologiques complexes. Ils comprennent notamment nos croyances, notre personnalité, nos convictions, d’une part; les normes sociales et culturelles que nous avons intégrées, d’une autre; et nos croyances de contrôle, soit notre sentiment quant à l’efficacité de ce que l’on va réaliser», explique la chercheuse Chantal Martin-Soelch, directrice du MAS en psychologie de la santé à l’université de Fribourg.
Transformation collective et conscientisation
Autrement dit, pour changer de comportement, il nous faut prendre en compte ces trois domaines. Or, très souvent, constate la chercheuse, la dimension sociale est sous-estimée, alors qu’elle est fondamentale. «Par exemple, les études montrent très bien que les changements d’habitudes alimentaires fonctionnent beaucoup mieux quand ils sont intégrés par l’entourage», décrit Chantal Martin-Soelch. Au final, pour changer de mode de vie, ce qui fonctionne, selon la science, c’est «le support social, le travail sur la motivation et sur les systèmes de pensée et une approche empathique», liste la psychologue.
Le support social passe en premier lieu par «une personne-ressource vers laquelle on peut se tourner en cas de besoin». Mais l’entraide peut aussi favoriser le support social, «car on ne se sent pas jugés si on est encouragés par des personnes qui partagent le même problème que nous». Enfin, la spiritualité est particulièrement efficace quand il s’agit de se défaire d’addictions sévères, «parce que la prise de drogues est souvent liée à une quête de sens», observe la chercheuse.
Quant aux changements de mode de vie drastiques, les recherches les plus récentes les déconseillent. Le concept même de régime n’est pas jugé efficace sur le long terme. «Il est plus efficace de modifier en profondeur toute son alimentation. Et de conserver une composante de plaisir!» observe Chantal Martin-Soelch. Pour Dragana Favre, les conflits de valeurs écologiques que nous vivons au quotidien devraient pouvoir donner lieu à des «transgressions conscientes», plus constructives que de la culpabilité. «Si on assume consciemment de transgresser une norme écologique, cette transgression n’a plus de pouvoir sur moi. Par contre, si cet écart devient quotidien, n’est pas conscientisé parce que j’en ai honte, alors on entre dans la dissociation: je n’assume pas les conséquences négatives de mes choix.»
Viser une croissance qualitative
La conscientisation est d’ailleurs une clé pour toute transformation de vie, rappelle Chantal Martin-Soelch, par ailleurs spécialiste des circuits de récompense du cerveau. La méditation et la pleine conscience peuvent permettre de ne pas être entraîné par des comportements «automatiques», programmés par le cerveau, et de construire d’autres connexions neuronales. Et pour celles et ceux que la pratique rebute, on peut aussi entraîner son cerveau à inhiber ses circuits de récompense «automatisés», qui facilitent les comportements addictifs, au moyen d’applications et de jeux développés par des chercheurs.
Tous ces changements restent individuels. Au plan collectif, c’est tout notre cadre qui doit évoluer pour que nos normes et croyances s’adaptent aux limites planétaires. Pour Tho Ha Vinh, directeur de l’Institut Eurasia pour le bonheur et le bien-être (dont une antenne est basée à Palézieux, VD), qui réfléchit depuis des années au concept de «bonheur national brut», l’un des aspects à remettre en question reste la définition du concept de «croissance». «Je ne crois pas à la décroissance. On ne peut pas lutter contre la croissance, qui est une loi biologique et une aspiration profonde de l’humain. Par contre, il nous faut des alternatives à une croissance définie comme uniquement matérielle. La croissance psychique, psychologique, ou en matière de créativité, elle, n’a aucune limite!»