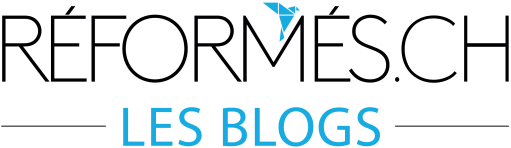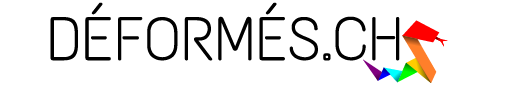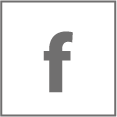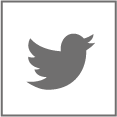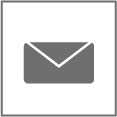«On ne peut pas parler des migrants qu’à travers le prisme de la politique»
«Cul-de-sac bosnien», le reportage radiophonique de la journaliste Gabrielle Desarzens de RTS Religion sur la situation des migrants bloqués en Bosnie par la frontière croate de l’Espace Schengen, a été honoré, ce 21 septembre, par le Prix catholique des médias de la Conférence des évêques suisses (CES). Les jurés ont souligné le professionnalisme de ce reportage qui «informe, d’une part, de la situation d’impasse dans laquelle se trouvent différents personnages, tout en rayonnant, d’autre part, d’une curiosité chrétienne pour la vie quotidienne et les perspectives d’avenir de ces réfugiés».
Ce n’est d’ailleurs de loin pas la première fois que cette journaliste, employée au sein d’un partenariat entre le service de médias protestants Médias-pro et la Fédération romande des Églises évangéliques (FREE), s’attache à donner la parole à ces existences en exil. Des mineurs non accompagnés à Scicli en Sicile à la «jungle» de Calais, en passant par Lampedusa ou encore Lesbos, Gabrielle Desarzens semble déterminée à tendre le micro à ceux qu’on ne veut pas voir. Plus qu’un seul reportage, ce prix consacre au final
un vrai engagement, aussi professionnel qu’existentiel. Rencontre.
Vous démontrez un réel attachement à la problématique des migrants. D’où vous vient cet intérêt pour cette cause?
C’est vrai, c’est une thématique qui m’a accompagnée tout au long de mon cursus professionnel. Au sortir de mes études de sciences politiques, j’ai même travaillé dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile géré par la Croix-Rouge suisse dans le canton de Vaud. Mon job consistait à les accueillir, leur expliquer comment ça fonctionne ici, leur donner des cours des français, essayer de leur trouver une première place de travail. Ensuite, j’ai aussi donné des cours de français pour élèves allophones dans les classes vaudoises. Je crois que cette préoccupation fait partie de mon ADN. Elle est sûrement liée à ma propre histoire familiale.
C’est-à-dire?
Mon grand-père, qui était Suisse mais avait épousé une Allemande, a quitté l’Allemagne à la montée du nazisme. Avec ma grand-mère et leurs trois enfants entre 5 et 12 ans, ils ont dû traverser le lac de Constance avec toutes leurs affaires contenues dans trois petites valises. C’est du moins l’image que je garde en tête alors qu’on en a très peu parlé en famille. Mais cela a été vécu comme un déchirement. Mon grand-père qui était ingénieur chez Mercedes-Benz n’a par la suite jamais retrouvé un travail similaire. Cette souffrance, ce sentiment de rejet, ces trajectoires fracassées, c’est ce que j’ai pu côtoyer dans le camp de Moria, sur l’île grecque de Lesbos, ou à Lampedusa. Ou même plus près de chez nous, comme cet Iranien que j’ai rencontré en Suisse dans le centre de demandeurs d’asile où j’ai travaillé, qui était professeur d’art dramatique à Téhéran, et qui se retrouvait à faire la cuisine dans un restaurant, parce que c’était le seul job que l’on trouvait pour lui. Il avait tout perdu, de son aura, de son environnement social et intellectuel...
Comment percevez-vous votre rôle de journaliste par rapport à ces problématiques?
Pour moi, il s’agit avant tout de leur donner une voix. Quand on s’intéresse à quelqu’un qui vit la migration et qu’on lui donne la possibilité de parler en «je», c’est une façon de lui rendre une dignité. Quand il peut dire qui il est, son nom, son prénom, et dire «voilà ce que j’ai vécu», «voilà ce que j’ai laissé», «voilà vers quoi je me projette», «je ne sais pas comment ça va se passer, mais en attendant mes conditions de vie sont celles-là et ça me fait mal». Il faut dire que ces gens ne quittent pas leur chez-soi parce que ça leur fait plaisir : ils aiment leur pays. Je me souviens, dans mon premier reportage en Sicile, de Mustafa, un jeune de 14 ans qui me racontait la traversée de la mer, mais aussi les pays qu’il avait traversés, les passeurs, etc. Il avait connu une panne de carburant, en pleine mer. Mais pour lui, me racontait-il, ce n’était rien par rapport à ce qu’il avait vécu à Idlib, en Syrie. Et là, on se rend compte que ces personnes ont juste quitté l’enfer, que ce n’est vraiment pas un voyage d’agrément.
Vous êtes très attachée au terrain. Qu’est-ce que celui-ci amène de plus?
La rencontre avec les premiers intéressés. On ne peut pas parler de ces existences qu’à travers le prisme de la politique ou de l’économie. On ne peut pas toujours parler «à la place de». Pour ce reportage primé, par exemple, il était évident pour moi qu’il fallait aller à la rencontre de ces migrants coincés à la frontière entre la Bosnie et la Croatie et qui voulaient absolument franchir ce mur pour être «enfin en Europe!». Après, ils regarderaient bien comment ils pourraient tenter de trouver leur chemin vers l’Allemagne, l’Angleterre ou la Suède – des destinations qu’on entend beaucoup dans leurs bouches. Sur ce reportage, j’ai d’ailleurs connu une énorme frustration.
Comment cela?
Je n’ai pas réussi à me rendre à la frontière, comme je le souhaitais, où un camp de migrants venait d’être démantelé. Je me suis donc concentrée sur la capitale, où beaucoup avaient reflué. Ils m’ont raconté cette espèce de «game», comme ils l’appelaient, où ils tentaient leurs chances pour passer la frontière, quitte à se faire ruer de coups s’ils étaient attrapés. Ils racontaient aussi des histoires où ils avaient été déshabillés, où on avait jeté leurs habits dans l’eau, où on leur avait pris leur téléphone – des choses extrêmement pénibles à entendre. Plusieurs étaient blessés. Ils étaient encore humiliés de ce qu’ils avaient vécu, mais ils allaient encore y retourner. Ces personnes prennent des risques incroyables.
J’ai été notamment bouleversée par cette femme africaine qui était seule avec ses quatre enfants. Elle allait au-devant de cette frontière, m’a dit qu’elle essayerait à tout prix de la passer, sachant pourtant que peut-être l’un de ses enfants pourrait mourir dans l’affrontement. Là tu te dis: «Mais qu’est-ce que ces personnes ont vécu pour prendre de tels risques ?»
Que représente aujourd’hui ce prix à vos yeux?
Je suis heureuse d’être primée comme journaliste. Pour moi, c’est une reconnaissance à la fois de la profession, mais aussi de personnes qui partagent les mêmes valeurs de solidarité et d’accueil que moi. J’ai d’ailleurs été beaucoup touchée que l’on relève mon intérêt pour l’autre, car c’est cela qui m’a poussée vers le journalisme: ce désir de faire entendre toute une frange de la population qui n’a souvent pas droit au chapitre. D’ailleurs, j’ai informé mes contacts – des migrants comme des habitants – à Lesbos et en Bosnie de ce prix. Ça leur a fait grand plaisir, car cela signifie que leur voix a porté. Pour moi, c’est cela qui me réjouit le plus.